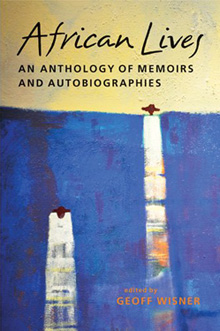Elle était située à Antsaralalana, qui voulait dire beau chemin. C'était à gauche de la gare avec au bout de la rue, un restaurant, « Le Lyonnais ».
Cette maison avait une particularité, elle était en partie écroulée et avait deux étages : eux étaient au deuxième étage et partageaient l'appartement avec une collègue célibataire de sa mère qui avait sa zone indépendante, mais on faisait salle de bain commune. La colocation permettait de payer le loyer. Au premier étage, il y avait une famille malgache avec deux garçons de son âge. Il y passait beaucoup de temps ; leur boy, l'inoubliable Lita, racontait des histoires extraordinaires à partir du jeu d'ombres de la cuisinière à charbon : le charbon incandescent tombait régulièrement derrière une sorte d'écran lumineux qui permettait à l'imagination du boy-cuisinier de raconter aux enfants mille contes fantastiques avec des dragons, des sorciers, des guerriers légendaires.
La cour était un vaste désordre où se retrouvaient pêle-mêle, les restes de la partie écroulée de la maison, un atelier avec des machines, un coin avec de haltères, ferrailles récupérées sur du matériel ferroviaire de la gare toute proche et des barres fixes où tous les enfants faisaient du sport sans oublier les concours de longueur de jets de pisse. C'est à l'occasion de ces concours qu'il découvrit qu'il n'était pas circoncis et que ses petits amis malgaches se moquèrent de lui. Sa mère lui dit qu'il avait été décidé qu'il ne serait pas circoncis parce qu'il n'avait plus de grand-père : la coutume voulait que le bout de prépuce enlevé soit intégré à une banane et mangé par le grand-père. On n'allait pas imposer cela à Dadabé, le doyen de la famille... Il pensa qu'il l'avait échappé belle et le « Vieux » aussi.
Il se disait que la maison s'était en partie écroulée parce que le commerçant grec voisin avait construit un immeuble de quatre étages. Ce commerçant avait un fils de son âge et lorsqu'il n'était pas avec ses amis malgaches, il jouait avec cet enfant grec : ils allaient dans les stocks du magasin de demi-gros du père et mangeaient du fromage de Hollande dans son enveloppe de paraffine rouge ou bien fabriquaient des jouets en « joujour », bois des nervures de feuilles de palmier, en créant principalement des avions piqués d'épingles recourbées qui permettaient de les faire glisser sur des fils tendus des balcons du quatrième étage vers le terrain vague d'en face. Avec les noyaux des « bibasses », ils fabriquaient des toupies, en les coupant en deux et en y plantant une moitié d'allumette.
Les garçons du premier étage avaient ce qu'ils appelaient des « kalèches », faites d'une planche de bois de trois roulements à bille dont un à l'avant servait de volant et ils filaient sur les trottoirs soit en se poussant les uns les autres soit en se propulsant avec une jambe, sorte de trottinette horizontale, fabriquée avec les moyens du bord : on inventait ses jouets.
Sa mère travaillait tard, son père, après la boutique, jouait souvent au 421 ou à la belote au bar-restaurant du coin. L'enfant avait sympathisé avec un enfant métropolitain qui habitait dans la rue, mais il sentait bien que la mère se méfiait de lui lorsqu'il alla chez eux. Il n'y fut plus invité car on le prenait sûrement pour un petit voyou créole, trop laissé à lui-même et passant trop de temps avec les Malgaches du quartier. Car il avait « sa bande » en dehors du copain grec et des voisins d'en dessous et il y avait parfois des bagarres avec les bandes des rues voisines. Ils allaient à plusieurs chez le vieil épicier chinois et pendant que les autres faisaient diversion, il volait des chewing-gums et des réglisses en rouleau. Avec les images de vedettes de cinéma américain qu'il y avait dans les chewing-gums, ils jouaient ensuite à lancer en l'air les images deux par deux, le chanceux gagnait les images lorsqu'elles retombaient face des acteurs vers le ciel. Les enfants connaissaient tous John Wayne et Gary Cooper...
L'enfant était assez fier qu'on le traite de « zlamboty », voyou de quartier, mais cela ne l'empêchait pas de trembler de peur lorsqu'il découvrait dans le terrain vague des papillons de nuit qui avaient comme des têtes de mort dessinées sur leurs ailes. Il croyait dur comme fer—croyance populaire—que c'était les âmes errantes des morts, dangereuses pour les vivants si on les touchait.
Il aima beaucoup la grande inondation de Tananarive : tout leur quartier était sous les eaux. Pendant quelques jours elles furent à mi-hauteur de l'escalier qui menait au premier étage. Il se rappelle sa joie de rentrer en pirogue chez lui.
L'enfant apprit beaucoup plus tard, que cet homme avait épousé quelques années plus tôt la fille aînée du premier mariage de son père, contre la volonté du père mais comme elle avait seize ans et que les parents étaient divorcés, la mère avait donné l'autorisation pour le mariage.
Il entendit souvent son père parler de cette désobéissance qu'il considérait comme une trahison et il avait dit à sa fille que si elle se mariait contre son gré il la renierait. C'est ce qu'il fit et il ne la revit jamais jusqu'à sa mort.
Il se réconcilia cependant avec l'huissier après qu'ils eurent divorcé. Ce n'est que bien des années après que l'enfant apprit que l'huissier était impuissant, que sa femme avait fait une « grossesse nerveuse » et que le médecin de brousse qui avait fait le diagnostic l'avait « soignée »... On lui dit que le mariage fut « cassé », aussi bien au civil qu'au religieux.
Le samedi soir, il faisait souvent une longue promenade avec ses parents, avenue de la Libération et c'était un régal d'acheter des arachides que l'on décortiquait et que l'on mangeait avec du pain. On finissait souvent la promenade par un pot à la terrasse du Glacier où l'enfant était émerveillé par une œuvre d'art : l'incrustation de milliers de capsules de bouteilles, jetées par les garçons de café, dans le goudron de la rue qui avait fondu. Les capsules donnaient un air de fête au « passage clouté », nom donné à l'époque aux passages protégés car ils étaient signalés par des gros clous d'aluminium plantés dans la chaussée.
Il se rappellera longtemps, avec colère, les quelques jours d'angoisse qu'il vécut avec sa sœur : un jour de crise, son père, fâché contre sa mère probablement pour des griefs de jalousie non fondés, les « enleva » de la maison avec quelques habits dans une valise et les cacha dans un hôtel avec interdiction de sortir. Combien de jours restèrent-ils, seuls, terrorisés par la colère du père, à espérer leur mère sans oser le dire, enfermés dans cet hôtel dont le personnel et le gérant les regardaient d'un drôle d'air. Les repas étaient sinistres face au père qui mangeait sans rien dire. Et puis la grand-mère Félicie joua la médiatrice et ils revinrent á la maison : quelle joie lorsque leur mère vint les chercher à l'hôtel, quelle rancœur chez l'enfant contre ses parents qui ne donnèrent aucune explication !
C'est à cette époque qu'il fit connaissance avec Luc Donat, célèbre musicien réunionnais de séga, principale danse de la Réunion. Son père le rencontrait dans un bar et quand l'enfant le sut, il demanda s'il pouvait apprendre le violon. Il commença à apprendre le solfège chez le musicien dans son appartement, vers l'avenue de la Libération. Il apprit très vite à lire la musique, mais tout s'arrêta brutalement : le musicien exigea, pour continuer, qu'il ait son violon ; son père après mille promesses lui dit qu'il n'avait pas les moyens d'acheter le violon... L'enfant rêva quelque temps devant la vitrine du marchand de violons. Il comprit beaucoup plus tard que les cours n'avaient pas été payés... Quelle déception pour lui, mais bof ! , ce n'en était qu'une de plus. Il mit une croix, il y en avait déjà tellement, sur ce rêve de jouer de la musique. Son cœur s'endurcissait, il ne fallait avoir envie de rien, c'était plus simple.
La seule chose qu'il avait pour lui et à laquelle il tenait, c'était sa collection de papillons : ils étaient épinglés dans une boite en bois vitrée, mais c'était lui qui les avait chassés et attrapés dans le grand terrain vague d'en face sa maison. Il avait un filet fabriqué avec de la moustiquaire et du formol pour les piquer et les conserver : il n'y en avait pas beaucoup mais ils étaient beaux.
Il allait souvent chez sa grand-mère Félicie et il montait et descendait les mille et une marches des escaliers interminables qui allaient de la place Colbert à la place du marché et de cette place à la maison de sa grand-mère sur la colline de Faravohitra. Quelle était belle sa ville du haut de tous ses escaliers. Et il faisait toujours autant de chemin pour aller à son école publique où il passait de la dernière place au classement à la première quand son père était convoqué par la maîtresse d'école et qu'il se prenait quelques fessées douloureuses.
Son père avait ouvert une boutique près d'un pâtissier grec, avenue de la Libération où il vit un jour de grande fête passer debout dans une grande voiture noire le Général de Gaulle qui venait annoncer la future loi-cadre, laquelle devait préfigurer une indépendance-association dans ce qu'on appelait la Grande Communauté Française. L'enfant était là dans la foule, sur les épaules de son père. Ce qu'il ne comprit pas c'est que de Gaulle inaugura une statue de Jeanne d'Arc et il se demanda, sans oser poser la question, ce que venait faire Jeanne d'Arc dans cette fête.
On était en août 1958.
Ce qui lui semblait important c'était le mot indépendance, car à part son petit copain grec et son père, il vivait dans un milieu « malgache » et ses amis de classe avaient les yeux qui brillaient lorsqu'ils en parlaient, probablement parce que leurs parents y plaçaient beaucoup d'espoir.
Il se souvient d'un après-midi où sa mère lui demanda de l'accompagner chez un « oncle ». Il habitait assez loin, dans le quartier de Besarety, dans la banlieue de Tananarive et s'appelait, on disait son nom avec respect mais en baissant la voix, Edmond Ravelonahina. Après un long trajet interminable en taxi collectif, durant lequel sa mère lui dit qu'elle était malade du cœur et qu'elle allait se faire soigner par radiesthésie, ils arrivèrent chez l'oncle. Il les accueillit chaleureusement en ne parlant que malgache. Il les mit dans une pièce isolée, et sa mère resta pendant près d'une heure, en tenant contre son cœur une sorte de rectangle gris de fer « aimanté ? » pour la guérir de son mal. L'oncle était « radiesthésiste », une sorte de « guérisseur » selon sa mère qui se sentit beaucoup mieux après cette séance, mais il avait aussi « fait de la politique et avait failli être tué ». En fit-elle d'autres de séances de radiesthésie ? Il ne le sait pas mais cela coûtait sûrement moins cher que le médecin. Il découvrit, des années plus tard, car il était tabou de parler des « évènements de 1947 », que Edmond Ravelonahina avait été condamné à mort après la révolte de 1947, et avait ensuite été gracié. Il avait déjà été déporté dans les années vingt à Mayotte, petite île des Comores, pour activisme dans les milieux nationalistes. Quelle fierté ressentit-il ce jour où il découvrit avoir eu un membre de sa famille qui s'était révolté contre la colonisation, même si des doutes existaient, semble-t-il, sur une période où il aurait servi d'agent de renseignements auprès des services secrets français. Des rumeurs courraient sur « son double jeu ».
Il faut savoir que, d'après les archives des armées françaises, qui ont pu être consultées, l'on peut estimer à 100000 le nombre de Malgaches qui furent tués ou qui moururent des suites de la répression militaire, pour mater leur rébellion dans les deux ans qui suivirent son déclenchement le 29 mars 1947. Il y eut le massacre des wagons plombés du train de Moramanga, de sinistre mémoire : le 5 mai 1947, quand les renforts militaires dépêchés permirent de contrer la rébellion, on chargea, à Ambatondrazaka, 166 otages dans trois wagons qui servaient habituellement au transport de zébus. A leur arrivée à Moramanga en début d'après-midi on les laissa dans le wagon. A minuit, ordre fut donné aux soldats qui les gardaient de tirer sur les wagons. A l'ouverture des wagons il restait 71 rescapés qui furent transférés à la prison de Moramanga pour être interrogés et torturés pendant deux jours puis remis dans les wagons pour en ressortir, hagards, le 8 mai et être exécutés sur ordre d'un certain général Casseville, chef du haut commandement militaire français de Madagascar. Tous les otages furent abattus au bord d'un charnier où les cadavres furent empilés. Un otage, seulement blessé, pourra fuir à la nuit tombée et ensuite témoigner devant l'histoire.